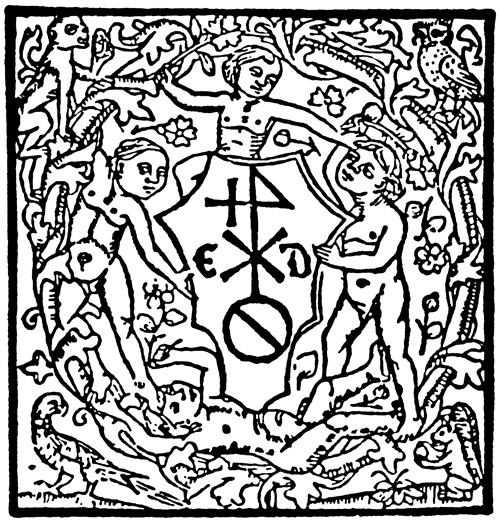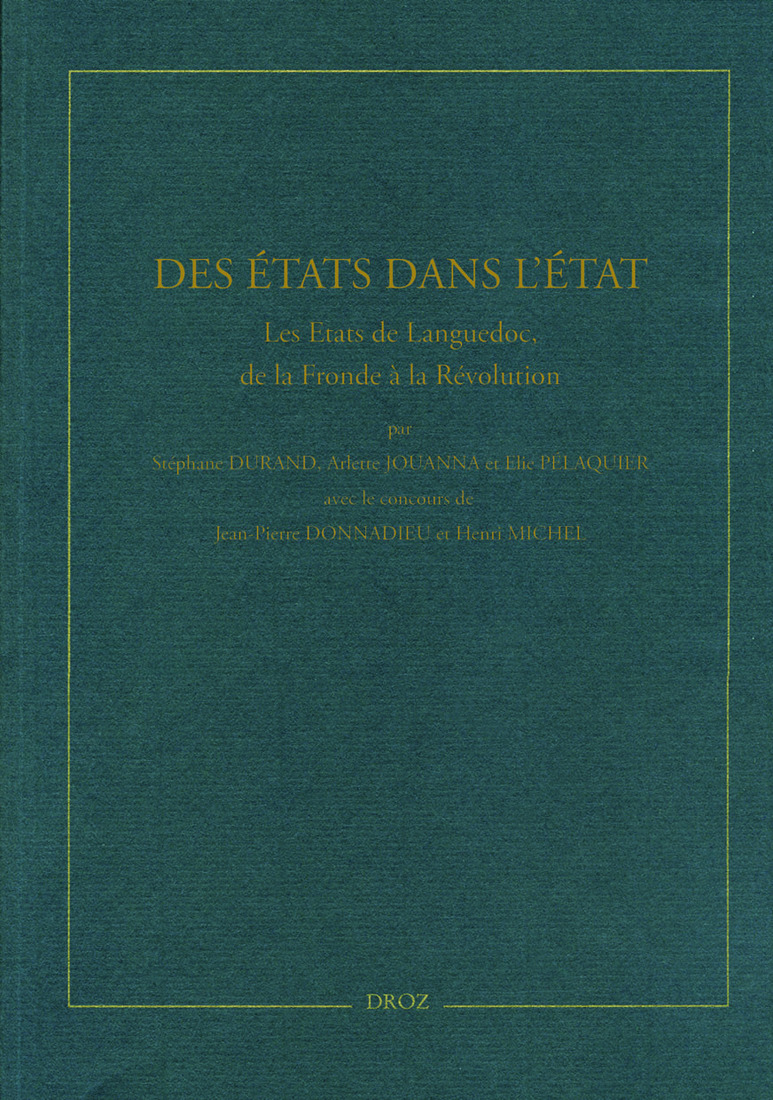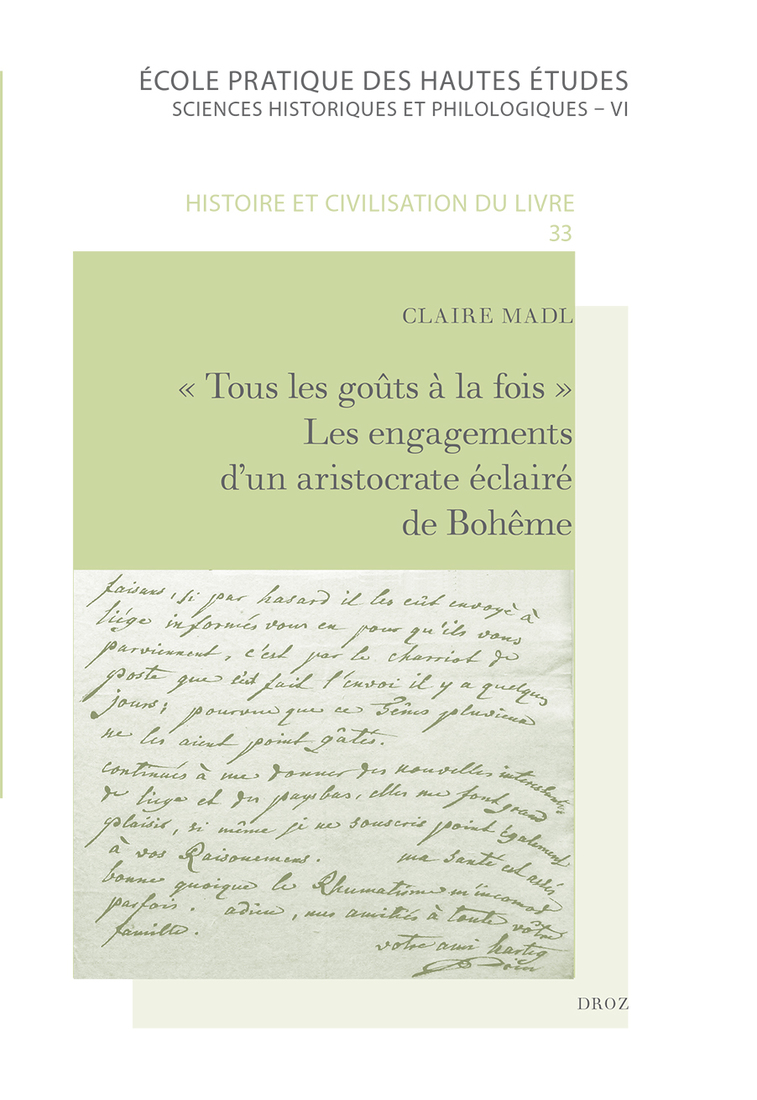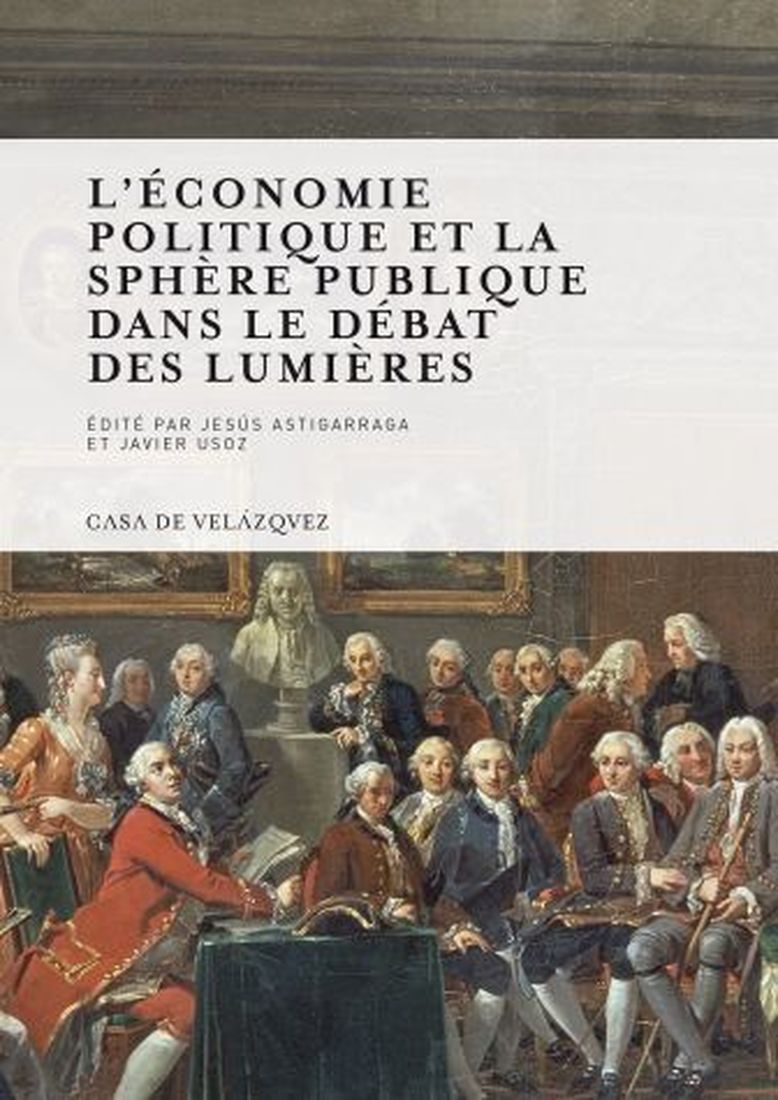XVIIIe siècle
Les États de Languedoc, assemblée délibérative composée des représentants du clergé, de la noblesse et du tiers état, ont géré la province de Languedoc depuis le XVe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Leurs séances étaient annuelles ; le vote était organisé par tête et non par ordre, originalité d’autant plus grande que le tiers disposait à lui seul du même nombre de voix que les deux premiers ordres réunis.
À partir du milieu du XVIIe siècle s’est affirmé leur rôle politique et économique. Outre la prérogative du consentement de l’impôt, pas toujours fictive, ils ont assumé des responsabilités croissantes dans le développement des voies de communication et la mise en valeur du territoire provincial. Leurs relations avec le pouvoir royal reposaient sur la négociation, le plus souvent déférente mais parfois traversée de tensions. Loin d’être des survivances archaïques d’un passé révolu, ils révèlent, par leur activité, un aspect méconnu de la monarchie, beaucoup moins centralisatrice et absolutiste qu’on ne le croit.
Table des matières
Préface
Remerciements
Avertissement linguistique
Introduction
Première partie : Ouverture par les savoirs. Le cosmopolitisme comme tradition familiale et principe d’Éducation
Chapitre I. — Talents, service, relations sociales et représentation
I. La « nouvelle » noblesse de Bohême
II. Des médecins princiers aux chevaliers d’Empire
III. Entrée dans les offices et ancrage en Bohême
IV. Des offices du royaume à la diplomatie
Chapitre II . — éducation d’un futur diplomate « allemand »
I. L’expérience du cosmopolitisme de Ratisbonne
II. Un enseignement grand ouvert
III. L’Empire germanique : une affaire de droit
IV. Le voyage de formation aux affaires
Chapitre III . — La bibliothèque, lieu d’ouverture
I. Une bibliothèque de Famille
II. La bibliothèque en son palais : une collection citadine
III. Des canaux d’acquisition déliés de contraintes
IV. Une bibliothèque équilibrée ?
Deuxième partie : Un espace à sa mesure. L’Europe des lettrés, l’Europe des diplomates
Chapitre IV. — L’Europe des lettrés, communauté en construction
I. Une certaine image des lettres européennes
II. Hartig auteur : stratégies de publication et construction d’une image
III. De la lecture à l’écriture. Imitation, modèles et glissements
Chapitre V. — L’Europe des princes ................................................................................... 179
I. Entrée en affaire, les pré-requis
II. Des affaires de l’Empire à celles de l’Europe
Chapitre VI. — Engagement en faveur de l’État, du souverain et de la gloire personnelle
I. Les réseaux de l’information
II. Service et critique : les modalités d’un engagement
Troisième partie: Terrains d’actions restreints pour un accès À l’universel
Chapitre VII . — L’« économie rurale », une mission
I. L’agriculture, une pratique scientifique
II. L’agriculture, un problème d’économie politique et sociale
III. Esthétique de la propriété
Chapitre VIII . — Modalités de l’engagement d’un noble dans le champ intellectuel et culturel
I. La collection privée pour le plaisir, le savoir et la renommée
II. Engagement sur le mode de la protection
III. Nouvelles figures du mécénat dans un espace public en construction
Chapitre IX . — La maladie, moyen d’accès à la postérité
I. Le salut par la connaissance
II. La maladie, qualité biologie et morale de la nature humaine
III. Sublimation morale de la maladie. Hartig face à la postérité
Conclusion
Sources et bibliographie
Annexes
I. Arbre généalogique simplifié de la famille Hartig
II. Travaux imprimés de Franz Anton Hartig
III. Airs gravés
IV. Écrits de Franz Anton Hartig conservées à l’état de manuscrit
Index des noms de personnes
Planches
Littérateur francophone introduit dans les salons parisiens, diplomate dans le Saint-Empire, protecteur des milieux intellectuels de Bohême, propriétaire terrien actif, malade en quête de sa guérison et de son salut, Franz Anton Hartig (1758-1797) fut un aristocrate aux curiosités multiples et aux vastes horizons d’action.
Sa personnalité permet avec une grande acuité d’observer comment s’articulent chez un aristocrate de la fin des Lumières les éléments traditionnels de l’identité nobiliaire avec des valeurs nouvelles et les opportunités inédites d’un espace public en pleine transformation.
S’appuyant sur la bibliothèque, les pratiques de lecture, les écrits, les publications mais aussi sur les activités tournées vers l’espace public de cet aristocrate, l’étude montre comment Hartig réinvente des communautés d’action qui ne doivent rien à un corporatisme nobiliaire exclusif : Europe des lettres, Europe politique, Saint-Empire et monarchie des Habsbourg, milieux érudits de Bohême, seigneurie, communauté humaine universelle.
Cette « biographie d’une bibliothèque et bibliographie d’une vie » (M. Espagne) apporte ainsi un éclairage en profondeur des réseaux et des modes de sociabilité dans une Europe « entière » ni cosmopolite ni dominée par le paradigme national.
CONTRIBUTEURS
BARDIN Pierre, Association Généalogie et Histoire de la Caraïbe.
BERNARDIN Florian, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
CHÉTANNEAU Sébastien, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
FAGOUR Yvelle, étudiante à l’Université des Antilles-Guyane (dir. É. Noël).
GRANGER Sylvie, maître de conférences à l’Université du Maine.
HAUDRÈRE Philippe, professeur à l’Université d’Angers.
MICHON Bernard, maître de conférences à l’Université de Nantes.
MITCHELL Robin, professeur assistante à Depaul University, Chicago.
NOËL Erick, professeur à l’Université des Antilles-Guyane.
PEABODY Sue, professeur à Washington State University.
RAFFIN Thomas, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
ROGERS Dominique, maître de conférences à l’Université des Antilles-Guyane.
SAUPIN Guy, professeur à l’Université de Nantes.
Le Dictionnaire des gens de couleur, après un volume consacré à Paris et à son bassin, approche ici tous ceux qui, passés en Bretagne, ont constitué la part la plus importante au terme d’un circuit triangulaire dominé par Nantes. Sur plus de 15 000 hommes et femmes amenés en France entre les grandes découvertes et la révolution, au moins la moitié ont en effet été retenus par la province la plus engagée dans le trafic négrier.
Cette situation est singulière : en plein siècle des Lumières, la capitale de la traite a réussi à faire avaliser un droit à l’esclavage dans un royaume où la liberté avait été érigée en principe fondamental. Méticuleusement analysés, les fonds des archives locales, aussi bien que départementales et nationales, à travers l’armement maritime, les registres des amirautés et jusqu’à ceux des paroisses, ont révélé l’existence de ces « nègres esclaves », rarement affranchis, dans l’ombre des moindres familles bourgeoises.
Ainsi découvrira-t-on, loin de l’Afrique et des Îles où ils avaient grandi, des cohortes de gens de maison et de métier, en théorie appelés à retourner sur les plantations d’où ils venaient. La réalité révèle surtout un monde de petites gens, capables de s’entraider dans des ports où ils pouvaient craindre un renvoi aux colonies et, dans le meilleur des cas, accéder à une liberté garantie par l’exercice d’une activité, parfois spécialisée, au sein de quartiers où leurs figures ont inspiré ces mascarons figés en façade des hôtels des négriers.
Dialogue ou roman? Les deux à la fois. D’un côté, un musicien bohême et un philosophe compassé se lancent dans un débat tortueux, sur tout et sur rien ; de l’autre, un récit dresse la scène et raconte les inénarrables pantomimes du Neveu. Le dialogue en fascinera plus d’un : Goethe, Hegel, Engels, Freud. Les interlocuteurs, LUI et MOI, parlent morale, politique, esthétique, et surtout musique et opéra. Mais leur conversation tourne à la satire pour épingler banquiers et "célébrités". Chef-d’œuvre bariolé, peinture d’un Ancien régime qui se dissout dans la corruption et la gabegie, Le Neveu de Rameau laisse pourtant se profiler, par la musique, une autre possibilité d’être, plus intérieure, plus souple, plus libérée de la convention.
Tour à tour profond et cocasse, enthousiaste et inquiet, cruel et affectueux, Diderot donne ici libre cours à une inventivité qui, de paradoxes en intuitions géniales, ne connaît pas de frein. Mais il déconcerte : où est-il ? qui est-il ? A l’encontre de Rousseau, son ex-ami, il se dérobe, sa pensée vagabonde.
La présente édition propose une annotation renouvelée et, à partir d’une information précise sur le contexte littéraire, théâtral et musical, avance de nouvelles interprétations.
Pierre et Marie-Hélène Servet rassemblent, pour la première fois dans une édition critique, plus de 90 testaments, fictifs dans leur immense majorité, écrits dans la lignée de l’œuvre de Villon entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle. Ces textes, inédits pour certains, souvent difficilement accessibles, sont accompagnés d’un apparat critique qui leur apporte la contextualisation et les éclairages historique, littéraire, linguistique, éditorial, indispensables. L’introduction générale propose une réflexion approfondie sur les sources juridiques – le testament civil – et littéraires, l’orientation facétieuse et/ou polémique de ces textes, la diversité de leurs registres, de la satire au pamphlet, et de leurs idéologies, leurs regroupements et leur évolution au fil des foyers pamphlétaires (guerres de religion, Mazarinades, phases de la Révolution). Cette édition permet ainsi de mettre au jour l’existence d’un nouveau genre littéraire, saisi dans son évolution, son apogée, son déclin ; elle propose aussi une réflexion plus générale sur la littérature de combat et sur le fonctionnement de la vie littéraire à travers les jeux de réécriture et de rééditions ; elle ouvre enfin des perspectives sur la subversion des formes et des genres par l’écriture polémique.
Alors que, depuis le XVIe siècle, la justice criminelle républicaine s’exerçait selon un usage ancien d’arbitrage, dès 1707 et surtout après 1760, des voix s’élèvent pour dénoncer la liberté des juges à l’égard du droit procédural et sentencieux. Bien qu’encadré par les lois fondamentales de la République, le pouvoir de justice, tel qu’il s’exerçait auparavant, est contesté. Le droit doit être parfaitement formalisé par les lois qui, d’une nature prescriptive, deviennent alors contraignantes. L’article sur la défense, rédigé hâtivement en 1734, participe de ce mouvement, car peu de temps après sa légalisation, des interprétations contradictoires naissent au moment de sa mise en pratique. Tout au long du XVIIIe siècle, la justice en général et la défense en particulier entreront dans le jeu des négociations sur le droit constitutionnel.
Surtout, la défense criminelle s’impose difficilement dans la justice. Légitimés par leur pouvoir d’arbitrage ancien, les juges proposent parfois à certains accusés un châtiment clément en contrepartie du renoncement à leur droit à l’avocat de la défense. Ce mode d’échange, qui rappelle le plea bargaining qui apparaît dans le droit anglo-saxon dès le XIXe siècle, est attesté par des traces archivistiques ténues qui illustrent d’ailleurs la discrétion de ces tractations. Ainsi, les pratiques négociées de la défense permettent de saisir comment, au XVIIIe siècle, la justice s’accommode des droits des accusés et procède du renforcement du légalisme républicain.
Table des matières / I. GARNIER et O. LEPATRE, « Introduction » – THEORIE – M.-H. SERVET, « Impertinent, Impertinence : les mots et la chose » ; M. LEVESQUE, « "Je m’en sers de ma seule autorité" : possibilité et enjeux d’un usage impertinent de la langue au XVIIe siècle » ; F. BOISSIERAS, « Approche rhétorique et pragmatique de la notion d’impertinence » – L’IMPERTINENCE GENERIQUE – A.-P. POUEY-MOUNOU, « Impertinences montaigniennes : la "suffisance" des Essais » ; M.-C. THOMINE-BICHARD « Les impertinences d’Eutrapel : Baliverneries (1548) et Contes et Discours d’Eutrapel (1585) » ; P. MOUNIER, « Le roman et l’humanisme : anticonformisme d’un genre à la Renaissance » ; A. ROOSE, « L’impropre et l’obscène dans Alector de Barthélémy Aneau » ; Y. CHARARA, « Les Aventures de Télémaque de Fénelon inspiration mystique et scandale générique » – LES GENRES DE L’IMPERTINENCE – M. AUBAGUE, « Les Trois Francion de Charles Sorel (1623, 1626, 1633) : impertinence générique et voix d’auteur » ; F. POULET, « De la satire des ridicules à la parrêsia : impertinence et extravagance dans l’histoire comique (1620-1660) » ; D. BERTRAND, « Impertinentes traversées urbaines : risque de la parrêsia et frontières de l’acceptabilité burlesque » ; H. DURANTON, « Au-delà de l’impertinence : la littérature satirique versifiée (1715-1789) » ; P. CAMBOU, « L’obscène et le saugrenu comme formes d’impertinence dans le conte voltairien » ; C. RAMON, « La transgression des libertins : une affaire de genre ? (Crébillon, Sade, Nerciat) » ; M. TSIMBIDY, « De l’impertinence des Mémoires ou des mémorialistes sous Louis XIV » ; K. ABIVEN, « Les impertinences de l’Histoire : une question d’aptum générique » ; F. WILD, « Savoir et impertinence dans les ana » ; P. GETHNER, « Le Proverbe dramatique, genre de l’impertinence » – Impertinence et bienséances – T. TRAN, « Les impertinences de la parole : collusions génériques et renversement satirique dans les Loups ravissans de Robert Gobin (c. 1505) » ; O. LEPLATRE, « L’impertinence des images : mont(r)er. A propos de l’Enigme joyeuse pour les bons esprits et du Centre de l’amour » ; P. EICHEL-LOJKINE, « Le conte merveilleux, un genre autorisant l’impertinence ? Bienséance, contrôle, image dans "Le Maître Chat ou le Chat Botté" » ; M.-M. FRAGONARD, « Livres de piété, prédication et modes féminines : l’enfer des bonnes intentions » ; C. ARONICA, « Quand les désirs sont désordre. Le corps impertinent de la tragédie classique » ; C. BARBAFIERI, « "La femme est le potage de l’homme" : les plaisanteries malséantes dans la France classique » ; M. BERMANN, « Les Contes et Nouvelles en vers ou une mondanité impertinente » ; C. LIGNEREUX, « Le conseil, un acte de langage contraire aux bienséances ? » – IMPERTINENCE, AUTORITE ET AUCTORIALITE – D. Reguig, « Impertinence et littérarité chez Boileau » ; C. BAHIER-PORTE, « Les réécritures "modernes" du bouclier d’Achille : l’inavouable pertinence d’un modèle inconvenant (Lesage, La Motte, Marivaux) » ; C. HAMMANN, « Pertinence du dé-plaire : une mise en cause de l’aptum dans les Lettres au XVIIIe siècle ».
L’impertinence a longtemps eu mauvaise presse. Sottise ou fatuité, extravagance ou importunité, l’impertinence choque, indispose, heurte l’usage ou la bienséance. Quand elle s’invite en littérature, elle fournit bien plus que l’étoffe de personnages de comédie – médecins ou coquettes – ou de romans burlesques : elle joue avec les codes sociaux et les normes de la représentation, bousculant les frontières des genres établis qu’elle subvertit ou régénère.
Après une mise en perspective conceptuelle de la notion, vingt-neuf études éclairent ici les multiples facettes de l’impertinence sous l’Ancien Régime. Elles les envisagent en diachronie d’un point de vue lexical, rhétorique, générique, en jouant de la complémentarité des approches. Composant un savoureux pot-pourri, roman, conte, histoire fabuleuse, énigme, recueil d’emblèmes, livres de piété, tragédie, mémoires, chansons satiriques, images tendancieuses, apparaissent tantôt comme lieux de l’impertinence générique, tantôt comme genres de l’impertinence.
Énergie créatrice au XVIe siècle, sulfureux débordement à canaliser au siècle classique, elle devient force émancipatrice pour les Lumières. En à peine plus d’un siècle, l’impertinence inverse totalement sa valeur socio-esthétique et contribue à faire jaillir la vérité en se soustrayant au carcan des codes. Stigmatisée comme vice par l’opinion commune, retournement de la folie en sagesse pour les écrivains indociles – qu’on peut considérer précurseurs –, elle apparaît comme qualité de l’intelligence et de l’esprit – pour ne pas dire vertu – et finit par imprégner toute une époque, valeur partagée d’un temps qui, par sa liberté de penser et d’écrire, marque encore le nôtre.
I. A Word from the general editor – II. Le dernier Diderot : autour de l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron – Didier Masseau, «Avant-propos» ; Colas Duflo, « Peut-on lire en philosophe sa propre actualité politique ? Le dernier Diderot et l’héritage de Montesquieu » ; Gianluigi Goggi, « Diderot-Raynal et quelques autres historiens des deux Indes face aux Créoles et aux sauvages » ; Eric Gatefin, «Entre souffrance et délectation : les états contradictoires de ‘‘celui qui les sert tous et qui n’en contente aucun’’ » ; Wilda Anderson, «Elements of the Aging Corps philosophique» ; Shane Agin, «Diderot, Rousseau and the Historiography of Virtue»; Jean-Jacques Tatin-Gourier, « Le philosophe, l’opinion et la mémoire dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron»; Didier Masseau, «L’enjeu d’une polémique : la figure de Sénèque dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron»; Jean Marie Goulemot, « La vieillesse des philosophes : le cas Diderot» – III. To Read or Not to Read. Questions of Readership and Reception in Eighteenth-Century France/ Lire ou ne pas lire. Questions de lecture et de réception dans la France du XVIIIe siècle – Anthony Wall, «Presentation»; Anthony Wall, «Lectures manquées» ; Colas Duflo, «Jacques le fataliste, l’antiroman dont vous êtes le héros»; Martin Schieder, «Searching for a Certain Nothing : Maurice-Quentin de La Tour and his Models for Modernity» ; Paul J. Young, «Reading for Oneself, Writing one’s own Destiny : Fontette de Sommery’s Lettres de Mademoiselle de Tourville à la Comtesse de Lénoncourt (1788) 293» – IV. Miscellaneous articles – Bertrand Binoche, «Une autre triarchie européenne : Rome, Paris, Pétersbourg» ; Laurence Mall, «Parerga ou ergon : la problématique du cadre dans les Salons de Diderot» ; Sarah Benharrech, «L’ambivalence de l’amphibie».
Table des matières: Jacques Berchtold, «Editorial»; Jean-Luc Guichet, «Sensibilité et Nature humaine chez Locke et Rousseau Locke, Condillac, Rousseau et la question de l’instinct »; Pascal Taranto, «Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau»; Catherine Larrère, «Locke et Rousseau : la place des femmes»; Blaise Bachofen, «Le sens du travail dans la théorie pédagogique de Locke et de Rousseau»; Thierry Ménissier, «Nature humaine et auto-institution de l’existence : le dialogue entre Locke et Rousseau par l’intermédiaire du mythe de Robinson»; Rudy Le Menthéour, «Au berceau de l’appropriation. Rousseau, Locke et l’enfance du propriétaire» - Articles variés - Jean Dagen, «La question de la preuve et la logique des Dialogues»; Martin Rueff, «Rousseau juge de Foucault ?»; Blaise Bachofen, «La nation, la patrie, le pays : la question de l’appartenance politique chez Rousseau»; Daniel Neicken, «Reyneau partout. Ou la méthode de résoudre le problème des mathématiques du Contrat social»; Céline Spector, «Vérité et subjectivité, des Essais aux Rêveries»; Frédéric S. Eigeldinger, «Comment Rousseau concevait le recueil de ses oeuvres»; Patrick Hochard, «D’une dédicace qui ne serait pas du compliment»; Catriona Seth, «Les cicatrices de Julie. Réflexions sur des marques textuelles»; Jean-Damien Mazaré, «‘‘Hoc erat in votis’’ : une réminiscence de la maison d’Horace dans les Confessions»; Marco Menin, «Rousseau au pays des fées. La Reine fantasque entre coeur et raison»; Serguey Zanin, «Réception de l’oeuvre de J.-J. Rousseau en Russie du XVIIIe au XXIe siècle»; Gauthier Ambrus, «Une cantate inédite de Rousseau sur Samson. Fragment inédit de la Bibliothèque de Genève»; François Jacob, «Actualités et activités de la Société J.-J. Rousseau».